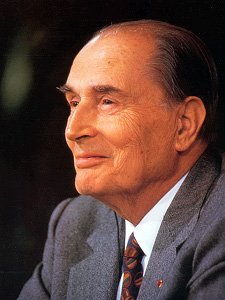 Rien
hormis la stratégie politique qui fera de lui progressivement le
principal opposant au général de Gaulle et au régime
qu'il s'apprête à fonder, la V République, et incontestablement,
le leader de la gauche. Sans doute, a-t-il, comme la plupart des responsables
politiques de la IV République, failli sombrer corps et bien avec
le 13 mai 1958. Il prit place pourtant parmi les quelques responsables
non gaullistes qui, à travers quelques messages et messagers discrets,
avaient fait savoir au chef de la France libre qu'ils étaient prêts
à favoriser son retour au pouvoir. Ce dernier n'en eut cure. Dès
lors, François Mitterrand, qui avait été entre-temps
remercié par ses électeurs de la Nièvre au point de
devoir trouver refuge au Sénat, eut tôt fait de comprendre
les mécanismes du nouveau régime né de la réforme
de 1962 instituant l'élection du président de la République
au suffrage universel. Il réalisa en effet que la présidentialisation
du régime contraindrait l'opposition, donc la gauche, à se
regrouper. Il mit alors toutes ses qualités, qui furent en l'espèce
celles d'un stratège politique, dans l'organisation opiniâtre
d'un rassemblement, autour de sa personne, des forces hostiles à
de Gaulle. Il le fit avec la parfaite mauvaise foi de celui qui s'oblige
à saisir toute occasion pour entretenir la flamme de l'opposition,
notamment à des institutions qu'il décrivit comme césariennes
et dont il devait accentuer plus tard lui-même la dérive monarchique. Rien
hormis la stratégie politique qui fera de lui progressivement le
principal opposant au général de Gaulle et au régime
qu'il s'apprête à fonder, la V République, et incontestablement,
le leader de la gauche. Sans doute, a-t-il, comme la plupart des responsables
politiques de la IV République, failli sombrer corps et bien avec
le 13 mai 1958. Il prit place pourtant parmi les quelques responsables
non gaullistes qui, à travers quelques messages et messagers discrets,
avaient fait savoir au chef de la France libre qu'ils étaient prêts
à favoriser son retour au pouvoir. Ce dernier n'en eut cure. Dès
lors, François Mitterrand, qui avait été entre-temps
remercié par ses électeurs de la Nièvre au point de
devoir trouver refuge au Sénat, eut tôt fait de comprendre
les mécanismes du nouveau régime né de la réforme
de 1962 instituant l'élection du président de la République
au suffrage universel. Il réalisa en effet que la présidentialisation
du régime contraindrait l'opposition, donc la gauche, à se
regrouper. Il mit alors toutes ses qualités, qui furent en l'espèce
celles d'un stratège politique, dans l'organisation opiniâtre
d'un rassemblement, autour de sa personne, des forces hostiles à
de Gaulle. Il le fit avec la parfaite mauvaise foi de celui qui s'oblige
à saisir toute occasion pour entretenir la flamme de l'opposition,
notamment à des institutions qu'il décrivit comme césariennes
et dont il devait accentuer plus tard lui-même la dérive monarchique.
En se donnant à François Mitterrand, la gauche s'est montrée
collectivement naïve ; elle a été istrumentalisée
par un homme qui a érigé l'exercice du pouvoir solitaire
en système. L'événement dominant de cette fin de siècle est, et restera, la mort de l'optimisme marxiste, celui-là même qui annonçait le bonheur pour demain, et dont était imprégnée l'idéologie qui a porté la gauche autour de François Mitterrand. A cet optimisme marxiste défunt s'oppose un optimisme libéral bien vivant, triomphant même. Ce dernier est souvent confondu avec une valeur de conservation. Le libéral n'est porteur de changements sociaux que malgré lui, par des effets induits. Il explique que la meilleure société possible est celle qui existe, ici et maintenant. Petit à petit, au fil de l'exercice du pouvoir, François Mitterrand s'est converti à l'idée que le meilleur état de la société française possible est celui qui prévaut sous son gouvernement. |
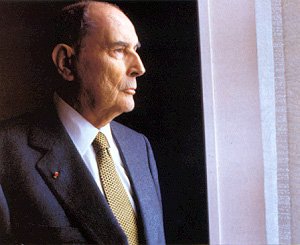 L'identification d'un peuple, le peuple de gauche, à un pouvoir
désormais inséparable d'un certain cynisme, ordonné
autour d'un dessein et d'un destin personnel : telle est l'ambiguïté
fondatrice du mitterrandisme. Le pouvoir, lorsqu'il ne laisse plus apparaître
d'autre ambition que celle de sa propre perpétuation en même
temps que la préservation de celui qui l'exerce, prend naturellement
à contre-pied tous ceux pour qui il ne saurait être qu'un
moyen de transformation sociale. Au demeurant, la trajectoire de François
Mitterrand s'inscrit dans une évolution plus large, qu'il ne maîtrise
pas plus qu'il ne la façonne.
L'identification d'un peuple, le peuple de gauche, à un pouvoir
désormais inséparable d'un certain cynisme, ordonné
autour d'un dessein et d'un destin personnel : telle est l'ambiguïté
fondatrice du mitterrandisme. Le pouvoir, lorsqu'il ne laisse plus apparaître
d'autre ambition que celle de sa propre perpétuation en même
temps que la préservation de celui qui l'exerce, prend naturellement
à contre-pied tous ceux pour qui il ne saurait être qu'un
moyen de transformation sociale. Au demeurant, la trajectoire de François
Mitterrand s'inscrit dans une évolution plus large, qu'il ne maîtrise
pas plus qu'il ne la façonne.