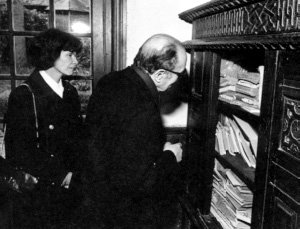 Néanmoins,
avant de considérer la gauche comme victime de François Mitterrand,
encore faut-il rappeler que celle-ci, livrée à elle-même,
n'a pas su produire une personnalité de cette dimension. Seule,
elle donne un Pierre Mauroy, au mieux un Pierre Bérégovoy
ou un Michel Rocard. Tous ses chefs historiques sont donc venus d'ailleurs.
Jean Jaurès était issu des rangs « opportunistes »,
l'une des familles républicaines d'alors qui participait au combat
pour l'installation de la République, mais consentait un certain
nombre d'accommodements. Néanmoins,
avant de considérer la gauche comme victime de François Mitterrand,
encore faut-il rappeler que celle-ci, livrée à elle-même,
n'a pas su produire une personnalité de cette dimension. Seule,
elle donne un Pierre Mauroy, au mieux un Pierre Bérégovoy
ou un Michel Rocard. Tous ses chefs historiques sont donc venus d'ailleurs.
Jean Jaurès était issu des rangs « opportunistes »,
l'une des familles républicaines d'alors qui participait au combat
pour l'installation de la République, mais consentait un certain
nombre d'accommodements.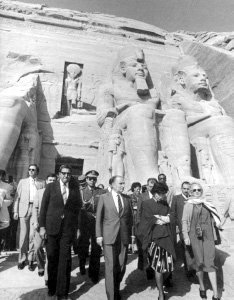 Léon Blum, quant à lui, était conseiller d'Etat :
le Conseil d'Etat n'était pas, et n'est d'ailleurs toujours pas,
une officine de recrutement pour les partis ouvriers. Le premier parti
dont François Mitterrand a été membre en tant que
parlementaire, l'UDSR (Union démocratique et socialiste de la Résistance),
pourrait être aisément qualifié d'opportuniste. Les
classes populaires ont de tous temps cherché un condottiere, animées
qu'elles sont d'un bonapartisme spontané : François Mitterrand
se situe dans cette continuité de conquête extérieure.
Mais il est aussi dans une parfaite continuité républicaine,
si l'on veut bien se souvenir de ce que Léon Gambetta avait appelé
« la révolution des places ». Celle-ci est devenue,
dans le vocable moderne, le spoil system, le système des dépouilles.
Maître d'institutions qui lui permettaient d'agir à sa guise,
François Mitterrand a très vite cédé à
la tentation d'une véritable hégémonie mitterrandiste,
à dire vrai peu différente de celles, antérieures,
des gaullistes puis des giscardiens, mais aggravée par l'apparition
d'un népotisme présidentiel combinant nominations politiques
dans les fonctions hiérarchiques de l'administration et clientélisme
pur et simple. Vis-à-vis de cette gauche à laquelle il n'appartient
pas et qu'il a gratifiée de ses largesses en la faisant
Léon Blum, quant à lui, était conseiller d'Etat :
le Conseil d'Etat n'était pas, et n'est d'ailleurs toujours pas,
une officine de recrutement pour les partis ouvriers. Le premier parti
dont François Mitterrand a été membre en tant que
parlementaire, l'UDSR (Union démocratique et socialiste de la Résistance),
pourrait être aisément qualifié d'opportuniste. Les
classes populaires ont de tous temps cherché un condottiere, animées
qu'elles sont d'un bonapartisme spontané : François Mitterrand
se situe dans cette continuité de conquête extérieure.
Mais il est aussi dans une parfaite continuité républicaine,
si l'on veut bien se souvenir de ce que Léon Gambetta avait appelé
« la révolution des places ». Celle-ci est devenue,
dans le vocable moderne, le spoil system, le système des dépouilles.
Maître d'institutions qui lui permettaient d'agir à sa guise,
François Mitterrand a très vite cédé à
la tentation d'une véritable hégémonie mitterrandiste,
à dire vrai peu différente de celles, antérieures,
des gaullistes puis des giscardiens, mais aggravée par l'apparition
d'un népotisme présidentiel combinant nominations politiques
dans les fonctions hiérarchiques de l'administration et clientélisme
pur et simple. Vis-à-vis de cette gauche à laquelle il n'appartient
pas et qu'il a gratifiée de ses largesses en la faisant
bénéficier de son sens aigu de l'amitié, il n'est pas exagéré de dire que François Mitterrand a toujours nourri un complexe d'illégitimité. |