 En
témoigne le célèbre mot de Pierre Mauroy au lendemain
du congrès d'Epinay, qui a vu en 1971 la victoire de François
Mitterrand et de ses partisans (dont Pierre Mauroy) sur l'équipe
d'Alain Savary pour la conquête du nouveau Parti socialiste. Celui
qui devait devenir le premier Premier ministre de François Mitterrand
avait alors lancé, commentant l'événement : «
C'est Arsène Lupin et ses complices ! » Les papiers de François
Mitterrand n'ont jamais été en règle vis-à-vis
de la gauche. Sa formation, à la fois catholique et monarchiste,
ne l'y prédisposait pas, pas plus que sa culture, solidement de
droite, ou sa longue carrière de ministre sous la IV République. En
témoigne le célèbre mot de Pierre Mauroy au lendemain
du congrès d'Epinay, qui a vu en 1971 la victoire de François
Mitterrand et de ses partisans (dont Pierre Mauroy) sur l'équipe
d'Alain Savary pour la conquête du nouveau Parti socialiste. Celui
qui devait devenir le premier Premier ministre de François Mitterrand
avait alors lancé, commentant l'événement : «
C'est Arsène Lupin et ses complices ! » Les papiers de François
Mitterrand n'ont jamais été en règle vis-à-vis
de la gauche. Sa formation, à la fois catholique et monarchiste,
ne l'y prédisposait pas, pas plus que sa culture, solidement de
droite, ou sa longue carrière de ministre sous la IV République.  Au
reste, n'avait-il pas été le ministre de l'intérieur
des débuts de la guerre d'Algérie et, pendant cette même
période, le garde des sceaux impuissant devant les multiples exécutions
sommaires auxquelles procéda l'autorité militaire ? Et lorsque
des poursuites contre de nombreux intellectuels de gauche, dont Georges
Lavau, furent engagées ? Cette absence de légitimité
l'a conduit constamment à de violents efforts pour ne jamais laisser
se développer de lui une image droitière. Voilà pourquoi
il a si mal toléré les critiques venues de gauche, tandis
que celles de droite le confortent. C'est pourquoi il a toujours laissé
le champ libre autour de lui aux idéologues, qu'il s'agisse de Jean-Pierre
Chevènement hier, ou plus modestement de polémistes comme
Julien Dray à la fin de son règne. C'est pourquoi également
il a toujours veillé à ne jamais se laisser doubler sur sa
droite, surtout lorsque celui qui double est, lui, en règle avec
la gauche, comme c'était le cas de Michel Rocard. La conséquence
concrète de ce combat pour son image a été la porte
ouverte à beaucoup de démagogie, Au
reste, n'avait-il pas été le ministre de l'intérieur
des débuts de la guerre d'Algérie et, pendant cette même
période, le garde des sceaux impuissant devant les multiples exécutions
sommaires auxquelles procéda l'autorité militaire ? Et lorsque
des poursuites contre de nombreux intellectuels de gauche, dont Georges
Lavau, furent engagées ? Cette absence de légitimité
l'a conduit constamment à de violents efforts pour ne jamais laisser
se développer de lui une image droitière. Voilà pourquoi
il a si mal toléré les critiques venues de gauche, tandis
que celles de droite le confortent. C'est pourquoi il a toujours laissé
le champ libre autour de lui aux idéologues, qu'il s'agisse de Jean-Pierre
Chevènement hier, ou plus modestement de polémistes comme
Julien Dray à la fin de son règne. C'est pourquoi également
il a toujours veillé à ne jamais se laisser doubler sur sa
droite, surtout lorsque celui qui double est, lui, en règle avec
la gauche, comme c'était le cas de Michel Rocard. La conséquence
concrète de ce combat pour son image a été la porte
ouverte à beaucoup de démagogie, 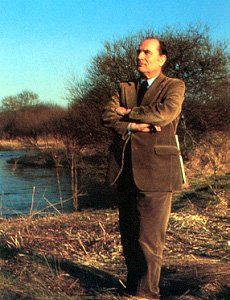 en
même temps que le refus de la pédagogie. en
même temps que le refus de la pédagogie.
A gauche, dans leur mouvement, Jaurès, Blum et Mendès ont essayé d'être des pédagogues de leur temps, soucieux d'intégrer la gauche dans la société française et son évolution. François Mitterrand, lui, a transmis quelques formidables leçons d'opiniâtreté dans la conquête du pouvoir, de sang-froid et de maestria dans sa reconquête, et de solides contre-exemples dans son exercice. C'est que l'homme a excellé davantage dans le combat et dans l'occupation de celui-ci que dans son usage. La raison en est que, dans la hiérarchie - officielle et officieuse - qu'il avait instituée autour de lui, il était le lieu unique, providentiel, de résolution des contradictions. Or lui-même ne cherchait pas à les résoudre : il les assumait, il vivait avec, il en tirait toutes les ressources. A charge pour les autres de « faire au mieux », de s'adapter. François Mitterrand a eu une pratique en quelque sorte lacanienne du pouvoir, laissant les désirs et leurs symptômes se développer, laissant se commettre les erreurs et attribuant à celles-ci, ex post, une valeur pédagogique. Ainsi, lors de la querelle scolaire, qui a culminé en juin 1984 avec une manifestation de près de deux millions de personnes, toutes convaincues que la gauche voulait porter atteinte à leur liberté de l'enseignement, il savait que son gouvernement allait droit dans le mur. Mais il ne voulait pas apparaître comme un défenseur de « l'école des curés », lui dont la propre soeur n'était autre que la secrétaire générale de l'enseignement catholique ! Il attendit donc que la preuve de l'erreur ait été faite, dans la rue, pour imposer le retrait du texte. |